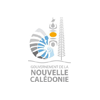Jeanne Adrian est enseignante-chercheuse en droit public à l’UNC. Découvrez son parcours en 10 questions.
1. Quel est votre parcours ?
Originaire du territoire, j’ai fait ma scolarité en Nouvelle-Calédonie, d’abord au lycée Jules Garnier, puis à l’UNC où j’ai obtenu une licence de droit. J’ai poursuivi en métropole avec une maîtrise, un DEA puis une thèse en droit public à la faculté d’Aix en Provence sur un sujet relatif à l’évolution institutionnelle de l’outre-mer au travers duquel j’ai eu l’opportunité d’étudier en profondeur l’accord de Nouméa et le statut de 1999 qui étaient très novateurs sur un grand nombre d’aspects juridiques. Ce sujet me permettait de partager mon temps entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie où j’étais vacataire à l’UNC. Dès l’obtention de mon doctorat, j’ai été recrutée pour travailler au sein des institutions à la province Sud puis au gouvernement comme chargée de mission. J’ai aussi travaillé une dizaine d’année chez Vale NC en tant que responsable juridique et des relations avec les institutions avant d’intégrer en 2018 l’UNC en qualité d’enseignante-chercheuse.
2. Quels sont vos domaines de recherches actuels ?
Mes activités de recherche sont traditionnellement liées aux institutions de l’outre-mer, et durant cet été par exemple je vais rédiger un fascicule sur le statut de Wallis et Futuna. C’est un statut très ancien, qui date de 1961, marqué donc par une grande stabilité, mais qui fait l’objet depuis quelques années de souhaits de réforme. Mes recherches portent également sur le droit minier néo-calédonien sur lequel il existe peu de publications.
3. Quels aspects considérez-vous comme les plus marquants de votre carrière ?
C’est avant tout la diversité de mon parcours professionnel qui me semble la plus marquante et la plus enrichissante. Tout au long de ma carrière, j’ai pu apporter ma petite pierre à l’édifice de l’évolution de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit dans le secteur public ou privé. Et ce sont à la fois cette polyvalence, cette diversité et cette richesse des échanges, des rencontres, des dossiers qui me marquent et me plaisent.
4. Quelles sont les applications de vos recherches ?
Je travaille par exemple sur le droit minier et cherche à faire le lien entre les aspects purement juridiques (code minier, schéma de mise en valeur des richesses minières) et ceux plus globaux de l’activité minière et de ses impacts sur l’économie de Nouvelle-Calédonie, que ce soit sur l’emploi, la fiscalité, mais aussi bien entendu sur l’environnement. La Nouvelle-Calédonie est un hot spot de la biodiversité, la nature l’a dotée d’une grande richesse, mais aussi d’une grande fragilité. Le contexte réglementaire est plus exigeant et stricte que dans bien d’autres pays. Il faut continuer à aller dans ce sens, trouver le bon équilibre entre respect de l’environnement et développement économique, s’engager dans des évolutions réglementaires qui permettent de faire de la Nouvelle-Calédonie le modèle d’un nickel vert ou plutôt durable qui répondrait aux trois piliers de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) que sont l’environnement, l’économie et le social.
5. Le quotidien d’une enseignante-chercheuse, c’est quoi au juste ?
Cela peut être très variable d’une journée et d’une semaine à l’autre : certaines semaines j’enseigne beaucoup en droit public ; d’autres je suis occupée avec toutes les activités annexes d’enseignante-chercheuse. Par exemple, en ma qualité de référent relations internationales pour le DEG (Département Economie et Gestion), je siège à la CORI (COmission des Relations Internationales), je m’occupe des mobilités des étudiants étrangers souhaitant venir étudier en Nouvelle-Calédonie mais aussi de nos étudiants souhaitant effectuer une expérience à l’international, ou encore par exemple je viens de participer au forum AFRAN (association franco-australienne de recherche et d’Innovation) qui cherche à développer des relations entre chercheurs et entre universités de Nouvelle-Calédonie et d’Australie... Je suis également coordonnatrice des stages des étudiants en droit ou encore directrice adjointe de notre laboratoire de recherche juridique et économique le LARJE, et m’occupe par exemple actuellement à ce titre de mettre à disposition les publications des chercheurs du DEG sur le site du LARJE. Je suis parfois sollicitée pour participer à des interventions dans les médias. Les activités sont très variées. Le reste du temps, je me consacre à la rédaction de mes articles en droit public.
6. Quel est le moment où vous vous êtes dit : je veux faire de la recherche ?
Depuis toujours, je dirais depuis l’université. Pour l’anecdote, je voulais faire des études d’économie à la base, mais mes parents voulant me garder encore un petit peu avec eux en Nouvelle-Calédonie après le bac (ce que je comprends si bien aujourd’hui avec des enfants…) m’ont vivement vanté et recommandé les études de droit à l’Université de la Nouvelle-Calédonie en me disant (après s’être renseignés tout de même !) que je pourrais après le DEUG de droit intégrer directement en métropole une deuxième année d’économie ! Finalement je me suis prise de passion pour les études de droit et ai voulu très vite aller le plus loin possible dans ces études pour devenir enseignant-chercheur.
7. Quelles sont vos plus belles réussites ?
Chaque expérience est enrichissante et ma plus belle réussite est de m’être épanouie et intégrée dans des milieux très divers et des domaines professionnels intéressants.
8. Quelles sont, selon vous, les principales qualités que doit avoir un chercheur ?
D’abord de la détermination : pour arriver à tout faire, aussi bien la recherche que tout ce qui va autour de l’activité d’enseignant-chercheur. Ensuite de la curiosité : un chercheur doit toujours avoir envie de découvrir d’autres domaines que le sien.
9. Quelle place accordez-vous au hasard (opportunités, rencontres, chance…) dans votre travail de recherche ?
Il me semble qu’il s’agit rarement de pur hasard, car ce qui nous arrive est beaucoup orienté par notre expérience passée et par notre ouverture aux autres, aux échanges. C’est un état d’esprit qui crée des opportunités. Je dirais que la participation à des colloques, débats ou aux conférences permettent de changer le quotidien, et de faire des rencontres et ainsi offrir de nouvelles opportunités.
10. Quelle-est, pour vous, la découverte majeure qui a pu influer sur l’histoire de la science et de l’humanité ?
Je ne citerai pas ici une découverte majeure mais une évolution technologique qui a révolutionné l’accès à l’information et au savoir, je veux parler de l’internet. Dans mon domaine, l’internet a considérablement facilité l’accès aux bases documentaires qui étaient jusque-là réservées aux seuls initiés. Précédemment, les codes, la jurisprudence, le Journal Officiel, les réglementations adoptées, les textes consolidés, étaient réservés aux spécialistes du droit uniquement qui devaient chacun dans leur coin faire leur travail de recension des textes, des modifications intervenues pour connaître le droit applicable dans une matière.... Aujourd’hui, cela s’est démocratisé grâce à Légifrance en métropole et Juridoc en Nouvelle-Calédonie. Ça a d’ailleurs été une fierté pour moi de contribuer à la création de Juridoc en Nouvelle-Calédonie aux côtés d’Anne Perrier-Gras lorsque je travaillais au gouvernement. Et cet outil est d’autant plus important localement que le principe de spécialité législative rend la connaissance du droit applicable encore plus compliquée à maîtriser. Cela reste selon moi un outil majeur à développer et à faire connaître.